Communiqué :
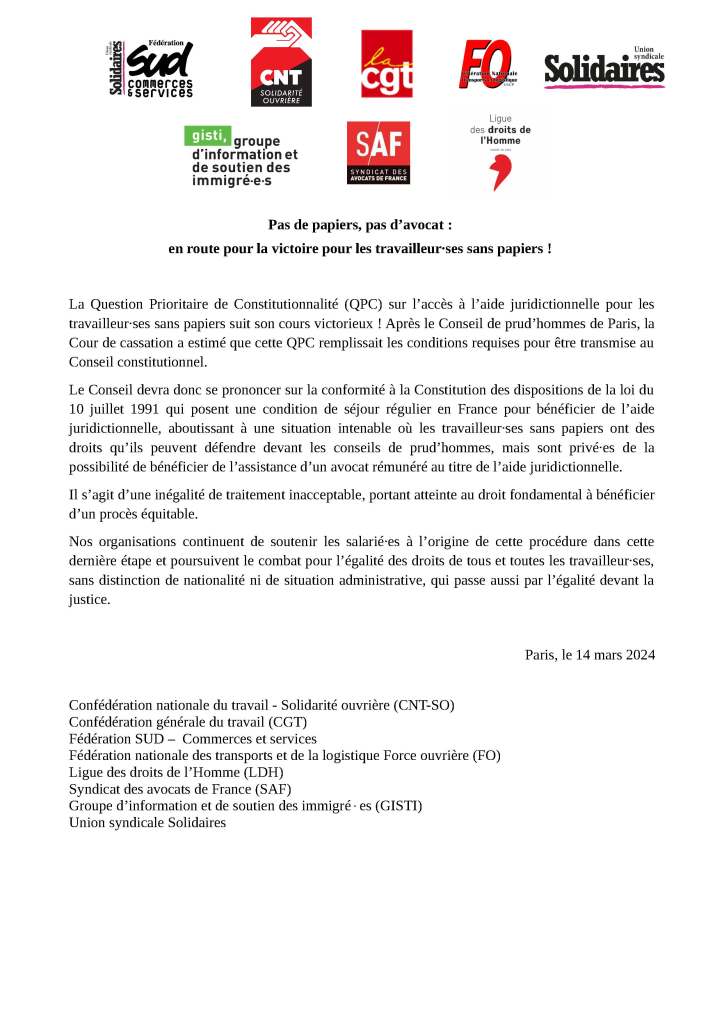
Article extrait de La Révolution prolétarienne n°823 (décembre 2023) :

Article paru dans La Révolution prolétarienne n°822 (septembre 2023):

Charles Piaget est décédé. Son nom est associé à l’aventure des Lip dans les années 1970. Mais comme il l’expliquait si bien lui-même, la fameuse mise en œuvre du slogan « On fabrique, on vend, on se paie » par les travailleurs et les travailleuses de Lip était le fruit de tout un travail syndical mené des années durant. Il a raconté celà dans de nombreuses publications ultérieurement. Plutôt que de tout réécrire plus mal que cela n’a été fait, mieux vaut se reporter à différents écrits de Charles, que ce soit des livres de lui-même On fabrique, on vend, on se paie, des articles de lui (Mai 68 chez Lip à Besançon – Les Utopiques), des livres où il est interviewé (La Force du collectif) ou dans lesquels il y a des écrits de lui (Lip vivra !, Lip Unité, Autogestion et révolution. Interventions).

Charles Piaget, militant jusqu’à la fin de sa vie, était présent lors des débats organisés à l’occasion des 50 ans de Mai 68 : Autogestion Mai 68 – Vidéos – Les Utopiques. Sa santé n’avait pu permettre sa participation à la dernière initiative, celle de juin 2023 : 50 ans après, que nous dit aujourd’hui la lutte des Lip.

Conclusion de l’Analyse du conflit « retraites » du premier semestre 2023 par l’Union nationale interprofessionnelle des retraité-es de Solidaires (UNIRS) :
Les organisations syndicales qui se disent « de transformation sociale » doivent savoir lier le syndicalisme dit « de masse », à savoir un syndicalisme qui pèse réellement par le nombre, qui ne soit pas minoritaire, mais qui soit un élément signifiant dans le mouvement ouvrier, et un syndicalisme dit « de classe », à savoir avec une vision cohérente du monde, avec une chaîne de revendications allant du local au global, du cas particulier à la remise en cause du système qui génère toutes ces inégalités et ces injustices. Il faut donc savoir parler aux travailleurs et aux travailleuses et surtout, sans doute, les écouter, les entendre, faire son « boulot » de militante et de militant, tout simplement. Il faut prendre nos camarades de travail comme ils et elles sont, façonnés, influencés par le travail, par l’organisation du travail, par le management, par le système hiérarchique et de promotion, par le système capitaliste de course à la production et à la consommation, un grand nombre plus ou moins sous l’influence de l’idéologie dominante. Et, en même temps, leur permettre d’envisager, ensemble, d’autres possibles, d’autres rapports sociaux et humains. C’est cette action syndicale qu’il nous faut mener au quotidien pour gagner progressivement des batailles culturelles, pour que d’autres espoirs renaissent.
Extrait de La RP n°821 (juin 2023) :

Article paru dans La RP n°818 (septembre 2022):

Suite à sa rencontre avec Elisabeth Borne le 17 mai 2023, la direction de la CGT a fait une déclaration, dont voici les principaux extraits, après y avoir rappelé son opposition à la réforme sur les retraites :
« Ce rendez-vous a été aussi l’occasion d’aborder les sujets de préoccupation majeurs des salariés·es et notamment :
– l’augmentation des salaires grâce à leur indexation sur l’inflation ;
– la révision des ordonnances Macron ;
– la conditionnalité des aides publiques aux entreprises ;
– la réduction du temps de travail ;
– l’égalité salariale et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail.
La CGT a rappelé son exigence de négociation tripartite sur les demandes syndicales. L’agenda social est celui des syndicats, pas celui du gouvernement ou du patronat. L’intersyndicale présentera donc le 30 mai ses premières propositions communes.
Nous ne voulons plus de mesures en coquille vide. Nous refuserons également de discuter sur la base d’un agenda patronal ou gouvernemental régressif.
Ce rendez-vous de « dialogue social » s’est avéré être un monologue patronal. »
Dans un précédent article en ligne « Y aller ou pas ? », on avait défendu une réponse positive, à condition d’une position claire sur la méthode et le cadre des rencontres avec le gouvernement.
La déclaration de la CGT ci-dessus va dans le sens de cette clarification, qui a manqué dans les dernières années, au moins. Nous étions habitué.es à voir la direction de la CGT se rendre à ces rencontres, et parfois à ne pas y aller, mais pour des raisons tenant plus à leur contenu qu’à leur cadre.
Ici la direction confédérale semble formaliser des critères que l’on ne peut que saluer : « exigence de négociation tripartite », « L’agenda est celui des syndicats », refus de « discuter sur la base d’un agenda patronal ou gouvernemental régressif ». Ce sont des critères qui dessinent une position qui commence à tourner le dos au « dialogue social ». On peut les résumer par : on arrête de perdre notre temps dans des réunions qui ne débouchent sur aucun texte normatif, qui oblige à faire ; on arrête de se laisser imposer dans les réunions un ordre du jour régressif pour les salarié.es.
Est-ce que cette position sera tenue dans la durée ? Est-ce qu’elle va faire école dans l’ensemble des structures de la CGT, des syndicats aux fédérations, en passant par les comités régionaux et unions départementales ? Est-ce qu’elle sera élargie à l’ensemble des activités de la confédération CGT ? Parce que si c’est le cas, et cela devrait l’être si on compte vraiment tourner le dos au « dialogue social », il y a du boulot en perspective … ! Ce serait là aussi un axe d’unité d’action possible à débattre avec d’autres organisations du syndicalisme de lutte, comme Solidaires et la FSU.
Michel T (militant UL-CGT)
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.